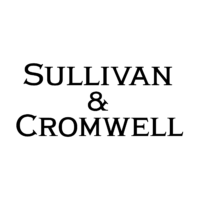Avec les contributions de Jean-Eric Schoettl, Laurent Vallée et Wanda Mastor
Jean-Eric Schoettl, Ancien Secrétaire général du Conseil constitutionnel
Depuis la parution de mon livre (« La démocratie au péril des prétoires »), on me demande souvent : comment un ancien secrétaire général du Conseil
constitutionnel peut-il en arriver à dénoncer la toute-puissance du pouvoir juridictionnel ? N’est-ce pas brûler ce qu’on a adoré ?
Je réponds que, bien au contraire, ce livre tente d’exprimer la conviction qui m’a toujours habité, conviction selon laquelle :
- Le juge doit occuper sa juste place dans le jeu démocratique de la séparation des pouvoirs ;
- Il doit exercer tout son office, mais rien que son office ; assumer la plénitude de ses prérogatives, non les outrepasser.
Comment contester que, depuis quelques décennies, la tendance est non à la retenue du juge, de toutes les catégories de juges, mais – qu’on le déplore ou
qu’on s’en réjouisse – à l’accroissement de son emprise ?
L’extension du contrôle juridictionnel est en grande partie l’œuvre du constituant (par exemple avec l’institution de la « question prioritaire de constitutionnalité »), ainsi que du législateur (par exemple avec le référé libertés). Dans cette mesure, c’est vrai, elle a été largement consentie par le
politique et celui-ci n’a à s’en prendre qu’à lui-même s’il trouve ce contrôle étouffant. Mais elle est aussi le fait du juge lui-même.
C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a décidé en 1971 qu’il contrôlerait la conformité de la loi à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, au Préambule de la Constitution de 1946 et aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ainsi encore, le Conseil constitutionnel a pris sur lui d’enjoindre au juge du fond, en 1975 (IVG), d’écarter la loi contraire au traité, même lorsqu’elle lui était postérieure.
Ainsi toujours, en 2020, il s’octroie le pouvoir de contrôler, au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, les ordonnances non ratifiées(lesquelles contribuent aujourd’hui, pour une part substantielle, à la production normative).
Le contrôle des juges nationaux et supranationaux sur les pouvoirs publics s’étend donc en surface. Il s’est également et considérablement étendu en profondeur au titre du principe de proportionnalité ou (s’agissant du Conseil constitutionnel) de l’incompétence négative, ce qui conduit bien souvent le juge à substituer son appréciation à celle du législateur ou de l’administration.
En témoigne l’ordonnance de référé du Conseil d’Etat du 22 juin 2021 sur l’assurance-chômage, à rapprocher du feuilleton « Commune de Grande Synthe » sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans la première affaire, il enjoint au gouvernement de ralentir la mise à exécution d’une mesure. Dans la seconde – l’« affaire du siècle » – il lui ordonne de hâter le pas.
Dans les deux cas, le juge détermine le rythme des réformes.
Cette extension du pouvoir du juge, sur le plan des compétences et des méthodes, s’exprime évidemment dans sa jurisprudence. Dans bien des domaines (maintien de l’ordre public, procédure pénale, droit des étrangers par exemple), la jurisprudence des cours suprêmes, nationales et européennes, formate les politiques publiques, si bien que, à l’inverse de ce que suggère le libellé de ce colloque, ce n’est pas le politique qui assujettit le droit, mais le droit qui assujettit le politique. Un droit qui trouve de moins en moins son siège dans la loi et qui a de plus en plus son assise dans le traité et la jurisprudence. Un droit qui s’émancipe de la loi, contraint la loi et évince la loi.
Et donc un juge qui, au travers des plaintes pénales, des référés, des recours constitutionnels et des saisines des cours suprêmes et organes para-juridictionnels nationaux et supranationaux, accroît son emprise sur le politique, à tous les niveaux de gouvernance.
Et donc un juge qui en vient, au moins dans certains domaines importants de l’action publique, à configurer les politiques sans avoir la « focale » des élus et des gouvernants, ni détenir l’expertise des administrations, ni encourir la responsabilité (budgétaire et électorale) des pouvoirs publics issus de l’élection, ni jouir de la légitimité démocratique…
Et donc aussi une justice qui, malgré la diversité des statuts et la disparité des moyens, se pense comme un contre-pouvoir et y puise une forme de satisfaction narcissique.
Donc oui, je pense que la démocratie représentative souffre aujourd’hui de l’hypertrophie du pouvoir juridictionnel, national et supranational, et que nous traversons, depuis un demi-siècle, une crise qui n’est pas sans rappeler celle qu’a connue l’ancien régime avec ses parlements.
L’emprise croissante du juge sur la démocratie revêt deux aspects distincts, quoique non étrangers l’un à l’autre :
- Le droit se construit désormais de plus en plus en dehors de la loi, voire contre elle ;
- La judiciarisation de la vie publique prend des proportions paralysantes.
Ces deux aspects sont liés car ils conduisent tous deux à l’abaissement de la figure du Représentant :
- Le premier en restreignant toujours plus étroitement sa latitude décisionnelle ;
- Le second en faisant du Représentant un perpétuel suspect.
Commençons par le second : l’irruption du pénal dans la politique.
Elle est d’abord imputable à un état d’esprit dont on peut trouver l’origine dans la célèbre harangue qu’Oswald Baudot, substitut à Marseille et membre du Syndicat de la magistrature, adresse en août 1974 à ses collègues débutants : « Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d’un même poids, il faut que vous la fassiez pencher d’un côté… ».
Ce manichéisme interventionniste imprègne l’idéologie du Syndicat de la magistrature qui, contrairement à ce que dit la presse, n’est pas un syndicat de gauche, mais d’extrême gauche (le syndicat de gauche c’est l’USM) et qui regroupe un tiers des magistrats, ce qui n’est pas rien. Ce manichéisme militant se lit sur « Mur des cons ». Ou dans la « contre-circulaire » que le Syndicat de la magistrature adresse, le 6 juin dernier, à ses ressortissants pour prendre le contre-pied systématique de la dépêche du 23 mars précédent du garde des sceaux relative à la poursuite des violences commises contre les élus et les forces de l’ordre. Là où le ministre de la justice incite les parquets au transfèrement des auteurs d’agressions contre les forces de l’ordre, la contre-circulaire invite au non transfèrement et encourage, à l’inverse, à poursuivre les agents de l’ordre pour usage « illégitime » de la force publique.
Ce manichéisme se retrouve dans nombre de jugements qui, faisant un usage intempestif de certaines théories juridiques (état de nécessité, voie de fait…),donnent tort au « système ». Je vous renvoie :
- à l’affaire des décrocheurs des portraits du Président de la République à Lyon,
- à l’affaire Vincent Lambert,
- à l’annulation de l’opération Huambushu par le tribunal judiciaire de Mayotte,
- Et, de façon générale, au réflexe conditionné de sévérité envers les réputés« dominants » en matière d’autodéfense et de squats.
Beaucoup de magistrats estiment avoir un rôle rédempteur dans une société marquée par les rapports de domination. Et, au premier rang des dominants, les responsables politiques. Aux yeux de beaucoup de magistrats, les responsables politiques sont a priori suspects de corruption, d’abus de pouvoir et de négligence. Au nom du devoir d’exemplarité, un délit commis par un politique, même en dehors de l’exercice de ses fonctions, est plus grave que celui commis par le malfrat ordinaire. Les poursuites, comme les sentences, expriment cette dissymétrie. Est ainsi réalisé le rêve d’Oswald Baudot : inverser la maxime du fabuliste : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs ».
Les affaires Sarkozy (Bétancourt, arbitrage Tapie, sondages de l’Elysée, Bygmalion, financement libyen, écoutes Bismuth avec cette première d’un ex-président de la République condamné à une année de port du bracelet électronique) ne sont pas les seules, loin de là, à voir l’autorité judiciaire faire preuve, à l’encontre des politiques, d’un zèle et d’une sévérité contrastant avec les suites plus accommodantes réservées, même lorsque les faits sont établis, aux agresseurs des élus et des dépositaires de l’autorité publique.
Avec l’affaire des assistants parlementaires de François Fillon, l’autorité judiciaire a plombé une campagne présidentielle en marginalisant le débat sur les enjeux de l’élection. La qualification de détournement de fonds publics est tirée par les cheveux, car l’article 432-15 du code pénal[1], qui définit le détournement de fonds publics (et fonde les poursuites), ne mentionne pas les élus. Or le code pénal, dans sa partie relative aux manquements au devoir de probité, lorsqu’il veut inclure les élus dans le champ d’une infraction, le dit toujours expressément.
Ainsi encore, le 29 mars 2021, dans l’affaire du Médiator, le tribunal correctionnel de Paris juge que les activités des parlementaires au sein d’une mission d’information parlementaire ne sont couvertes par aucune immunité, nonobstant l’article 26 de la Constitution[2].
Que le politique méprise le droit est intolérable. Que le droit étouffe le politique ne l’est pas moins.
Ainsi toujours, depuis son entrée en fonctions, l’actuel garde des Sceaux est vilipendé par une bonne partie de la magistrature, que celle-ci s’exprime par la voix de ses syndicats, qui dénoncent, dans sa nomination, une « déclaration de guerre », ou d’une haute hiérarchie judiciaire qui ne craint pas de le morigéner publiquement. Ces mêmes hautes autorités judiciaires pèsent sur le fonctionnement de la Cour de justice de la République (CJR) à tous les stades de la procédure surréaliste engagée contre le ministre de la justice et n’ont pas le réflexe de se déporter.
Il en va de même pour la crise sanitaire : en ouvrant les vannes de la recevabilité des plaintes, puis en perquisitionnant le domicile et le ministère d’Olivier Véran, au moment où celui-ci se battait contre une deuxième vague pandémique, puis en mettant en examen Agnès Buzyn et en plaçant sous statut de témoin assisté Edouard Philippe, les organes compétents de la Cour de justice de la République (Commission des requêtes et Commission d’instruction) laissent la Cour se faire instrumentaliser par la vindicte qui a saisi une partie de la société à l’égard des acteurs publics. S’agissant de la « mise en danger de la vie d’autrui » la Cour de cassation a heureusement dégonflé la baudruche le 20 janvier dernier.
L’opinion publique et les médias ont leur part de responsabilité dans cette dérive. La petite musique du « tous pourris » nous console de nos frustrations de citoyens, de notre rêve déçu de gouvernance efficace, de notre insignifiance politique personnelle.
Vous me direz qu’il arrive au Représentant de s’employer, parfois activement, à son propre abaissement : c’est vrai. Je pense aux scènes désolantes auxquelles nous avons assisté au Palais-Bourbon lors de l’examen de la loi sur les retraites.
On m’objectera également que l’affermissement de la fonction juridictionnelle, s’exerçant sur toutes les catégories d’actes des pouvoirs publics et sur les personnes de nos dirigeants, conduit à davantage de rigueur et de transparence dans le fonctionnement démocratique ; qu’elle nous met à l’abri d’aventures antidémocratiques ou de pulsions populistes…
J’admets parfaitement les deux objections. A telle enseigne que, dans la querelle des retraites, je me suis rangé sans barguigner dans le camp des institutions et non dans celui du populisme. Et j’ai vigoureusement défendu le Conseil constitutionnel.
Pour autant, je persiste et signe : certes, le prince doit désormais rendre compte au juge et le juge n’est plus aux ordres : deux excellentes nouvelles. Mais ces bonnes nouvelles sont ternies par le fait que le caprice du juge a souvent remplacé le caprice du prince. Le juge est indépendant du politique, il faut s’en féliciter. Mais inquiétons-nous aussitôt des questions suivantes :
- Que fait le juge de son indépendance ?
- S’émancipe-t-il aussi de ses préjugés ? de ses passions ? de ses conditionnements idéologiques ? de ses lubies ?
- Le leitmotiv de l’indépendance ne fait-il pas passer par pertes et profits la question de l’impartialité ?
Quand je dis que, trop souvent, le caprice du juge a remplacé le caprice du prince, je ne pose pas ce diagnostic d’un cœur léger. Il y a encore dix ans, je n’aurais pas imaginé faire un tel constat publiquement, ni même dans mon for intérieur.
La critique comporte sa part d’autocritique, qui débouche un examen de conscience. Cet examen consiste à se poser une question cruciale au moment de prendre une décision juridictionnelle ayant un fort impact sur les politiques publiques ou sur les titulaires de fonctions publiques.
Cette question la voici : même lorsque la solution retenue paraît satisfaisante moralement ou philosophiquement, est-ce bien à moi juge, plutôt qu’aux représentants élus de la Nation (ou au gouvernement responsable devant ceux-ci), de l’imposer à la société ?
- Est-ce à moi juge, plutôt qu’aux représentants élus de la Nation, de décider si l’insémination post mortem, c’est-à-dire par emploi des gamètes du mari défunt, doit être ou non possible (CE) ?
- Ou si le changement de genre doit être enregistré par l’état-civil à la seule demande de l’intéressé et sans production d’un certificat médical (CEDH) ?
- Ou si le regroupement familial des étrangers est de droit (CC) ?
- Ou si la présomption de minorité d’un étranger doit persister, en cas dedoute, même en cas de refus par l’intéressé de se prêter à la mesure de sonâge osseux (CEDH et CC) ?
- Ou si l’accès à l’université doit être gratuit et ne peut faire l’objet que dedroits d’inscription modiques (CC) ?
- Ou si la faculté de garder le silence doit être notifiée à la personne gardée àvue (CC) ?
- Ou si les drones utilisés par la police lors de manifestations peuvent ou non permettre d’identifier les fauteurs de trouble (CC) ?
- Ou si la CSG peut ou non être progressive (CC) ?
- Ou si des interdictions spatio-temporelles de pêche doivent être ordonnées pour éviter la capture non intentionnelle de petits cétacés ?
Sur tous ces sujets, la norme a été fixée non par le législateur, mais par une cour suprême, nationale ou supranationale.
Autre question : le juge n’a-t-il pas été habité par une vision de l’Etat de droit qui, par réaction contre la séculaire raison d’Etat, ne veut plus entendre que les raisons d’Antigone et récuse celles de Créon ? Oubliant, comme le disait Albert Camus, qu’« Antigone a raison, mais Créon n’a pas tort » ?
Plus généralement : quelle est la part du conformisme, de l’idéologie, du préjugé et de l’hubris, dans la position du juge ?
Ce que j’essaie d’expliquer dans mon livre tient aux constats suivants :
Primo : des prérogatives considérables ont été conférées aux différentes juridictions depuis une cinquantaine d’années et tout est devenu justiciable ;
Secundo : les dispositions supra-législatives dans lesquelles le juge va chercher l’énoncé d’un droit font l’objet de formulations le plus souvent vagues. Sa jurisprudence déterminera donc à la fois les implications véritables et la force contraignante de l’énoncé constitutionnel ou conventionnel en cause. La preuve par la valeur soudainement normative accordée par le Conseil constitutionnel au principe de fraternité ;
Tertio : ces pouvoirs considérables sont exercés par un corps distinct du Représentant, un corps qui applique des critères propres, qui ont leur validité, mais qui sont plus étroits que ceux que met en œuvre le Représentant, un corps qui applique des critères propres, qui ont leur validité, mais qui sont plus étroits que ceux que met en œuvre le Représentant lorsqu’il tente de formuler la volonté générale ; un corps qui a sa sociologie propre et sa propre vision du monde ;
Quarto : à la différence des autres pouvoirs, les juges ne sont responsables devant personne. Personne ne peut leur demander des comptes pour leur façon de juger.
La combinaison de ces quatre facteurs fait peser sur la démocratie un risque potentiel : celui que des politiques publiques, parfois cruciales, soient déterminées en dehors de la délibération démocratique et sans prendre en compte les intérêts supérieurs de la Nation. Il serait miraculeux que ce risque potentiel ne se réalise pas. De fait, il se réalise.
Il se réalise assez souvent pour concourir à la défiance de nos concitoyens à l’égard des institutions.
Il se réalise assez souvent pour inhiber les responsables publics, qu’ils soient élus ou fonctionnaires. La peur de la censure ou de la condamnation peut alors l’emporter sur la recherche de la meilleure décision du point de vue de l’intérêt général.
De ce qui précède, qui tient du constat et non du jugement de valeur, je tire l’idée qu’il faut, dans un pays comme la France, « recaler » le système institutionnel.
Il n’est pas question de jeter par-dessus bord la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux. Je ne me fais par ailleurs aucune illusion sur la faisabilité des remèdes de cheval que je propose à la fin de mon livre.
Mais puisse au moins des alertes comme celle que je lance inciter au débat sur ce que devrait être une séparation des pouvoirs moderne.
Une séparation des pouvoirs qui atténuerait l’excessif (mais explicable) retour de balancier qu’on observe aujourd’hui par rapport à ce que fut l’abaissement de la fonction juridictionnelle au début de la Vème République.
Laurent Vallée, Secrétaire général de Carrefour, Membre du Club des juristes et ancien Secrétaire général du Conseil constitutionnel
La thèse de Jean-Eric Schoettl est provocante dans tous les sens du terme : stimulante, hardie, et même un peu querelleuse.
La thèse d’une extension du pouvoir juridictionnel n’est pas propre à la France et paraît indiscutable. C’est sans doute l’un des phénomènes les plus significatifs au sein des démocraties depuis la fin du XXème siècle. La multiplication du nombre et des types de juridictions, nationales et internationales, la convergence globale des normes supérieures listées dans des catalogues de droits de plus en plus solidement établis, le pouvoir correspondant des juges d’apprécier la constitutionnalité des lois et, parfois, de les censurer, l’intensité croissante de leur contrôle sur les règlements, les régulations, les politiques publiques et même l’action politique sont incontestables.
Dotés de pouvoirs de contrôle étendus et constitutionnellement ancrés, les juges se sont emparés d’un nouveau pouvoir institutionnel qui s’explique aussi – ou est consolidé – par des évolutions démographiques, sociologiques et économiques. La simple hausse du volume des interactions humaines et des transactions économiques a conduit à une croissance exponentielle du nombre de normes et, par suite, du pouvoir des juges. Avec la globalisation s’est développé un complexe legalo-juridictionnel inédit. Plus de tribunaux avec plus de pouvoirs pour juger un ensemble justiciable plus vaste et plus complexe : cette évolution est incontestable.
Cette expansion du pouvoir juridictionnel suscite critiques et résistances. La nature contre-majoritaire de ce pouvoir, son caractère peu démocratique, la
supériorité du droit écrit sur la jurisprudence, la nécessité d’en revenir à des décisions prises par la souveraineté nationale sont mobilisés. Pour désigner à la fois l’ennemi et ce qui serait une usurpation de pouvoir à grande échelle sont utilisées les formules les plus frappantes : judiciarisation de la politique, législateurs en robe, aristocratie judiciaire et, bien sûr, l’expression centenaire « gouvernement des juges ».
À une période de croissance devrait succéder, pour le bien démocratique, une phase de récession juridictionnelle.
Le débat serait ainsi à la fois classique et renouvelé. Débat classique : il n’es tpas nouveau de dénoncer les progrès des pouvoirs des juges, en particulier ceux des cours constitutionnelles ou suprêmes, comme constituant un dommage à la pureté de la démocratie élective. Des questions essentielles seraient tranchées ailleurs qu’entre les mains des représentants ou sont objets d’un veto, à tout le moins d’un filtre, d’institutions ni élues ni responsables. Nous ne pouvons l’admettre qu’au nom d’une protection des droits fondamentaux et d’une prévention des excès des deux autres pouvoirs, justifiée en particulier par la crainte d’une domination excessive de la majorité. Débat renouvelé : par l’effet des causes qui viennent d’être rappelées, les juges se seraient arrogés un contrôle trop large et de fond sur la politique générale des gouvernements. Il s’agirait désormais d’une atteinte réelle à la souveraineté nationale et non plus seulement d’un écrêtement limité.
Il faut s’arrêter d’abord sur les termes employés dans ce débat. Si les expressions reprochant aux juges un exercice abusif de leurs pouvoirs ou leur activisme conservent une redoutable efficacité politique, celle-ci contraste avec la réalité juridique de leur contenu. C’est en particulier le cas de l’expression « Gouvernement des juges ». Son apparente évidence permet de jeter le discrédit sur des jugements ou, au contraire, d’en justifier d’autres parle renoncement raisonnable du juge à exercer son pouvoir usurpateur. Pour autant, il paraît inutile aujourd’hui de débattre sur le rôle créatif, normatif et politique du juge. Notre hôte Denys de Béchillon l’a parfaitement expliqué [3] :« tout acte de juger, qu’il soit interprétatif ou plus franchement « légiférant », est toujours et fondamentalement un acte politique, violent, et pour partie auto-institutif ». Mme la professeure Wanda Mastor le dit autrement : « il serait temps de ne plus utiliser une formule qui alimente des discours politiques peu compatibles avec l’idée républicaine et ne fait pas honneur aux débats scientifiques » .[4]
Il en est de même des termes d’activisme judiciaire ou, à l’opposé, de retenue et de modération qui veulent traduire le « self-restraint » anglo-saxon. On ne reproche leur « activisme » aux juges que lorsqu’ils sont « libéraux ». En ce cas seulement on critique des constructions jurisprudentielles fondées sur des droits qui n’auraient d’autre fondement que leurs préférences personnelles. Rare est le reproche d’activisme lorsque le juge statue dans un sens
« conservateur ». L’activisme serait asymétrique. Or, en vérité, la frontière entre activisme et retenue est aussi mince que celle qui sépare le conflit de normes de l’interprétation conforme : tout est question de perspective et de volonté. La décision French Data Network du Conseil d’État du 21 avril 2021[5] relative à l’obligation de conservation des données de connexion peut tout autant être regardée comme caractéristique d’un activisme – par ceux qui dénoncent le contrôle de l’applicabilité du droit de l’Union européenne – que de retenue –par ses soutiens qui louent son équilibre.
Utiliser ce vocabulaire et prendre appui sur des décisions juridictionnelles sélectionnées tend à biaiser l’analyse. La question est moins de savoir si le juge va parfois trop loin – sans qu’on sache toujours de quelle limite on parle – que de déterminer si le gouvernement et le législateur sont effectivement soumis à des contraintes telles que la souveraineté nationale devrait abdiquer devant les juges. Or, en France, les questions de politiques publiques les plus essentielles, sensibles ou controversées continuent d’être résolues dans l’arène politique et non dans les prétoires. Prenons, à titre d’exemple, le programme annoncé par l’actuel Président de la République pendant sa campagne : investissements dans les armées et refondation du pacte armée-nation, atteinte d’une plus grande indépendance énergétique, réforme sur le retour à l’emploi et la transformation de pôle emploi, réforme du RSA, élévation de l’âge de la retraite, évolution des établissements scolaires et universitaires, simplification des prestations sociales, renforcement de la politique de prévention en matière de santé … aucune de ces politiques et rien dans leur mise en œuvre n’apparaît bloqué, retardé ou diminué par les juridictions. Les difficultés d’exécution des orientations politiques retenues par le Gouvernement ont d’autres causes que l’encadrement juridique et l’activité juridictionnelle.
La menace des juges se concentrerait néanmoins sur la matière régalienne. Notre capacité de répondre aux menaces modernes et notre liberté d’organisation en matière de sécurité seraient entravées par les normes supérieures à la loi et leur application par les juridictions. Tout est ici question d’appréciation et celle-ci impliquerait davantage d’expertise sur certaines questions spécifiques de sécurité. Pour autant, deux séries d’observations permettent de tempérer l’idée d’un désarmement de l’Etat.
En premier lieu, si l’on examine la jurisprudence constitutionnelle entre 2015 –cette année étant retenue comme pertinente dès lors qu’elle a été à la fois celle de l’intervention de la décision sur la loi Renseignement[6] et de la tragédie de novembre – et aujourd’hui, avec la dernière décision du Conseil constitutionnel relative à la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024[7], il ne paraît pas possible d’affirmer que celui-ci aurait empêché la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’Etat pour garantir la sécurité. Techniques de renseignement, mesures de surveillance et de restriction de déplacement applicables à des personnes particulièrement menaçantes, dispositifs permettant de prendre des mesures en amont de manifestations, extension de la video-protection … le Conseil constitutionnel a jugé conformes à plupart des dispositions qui assurent la liberté qui, comme la définit Montesquieu, « est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté »[8]. A-t-il exercé son office avec trop de pointillisme ou d’exigence dans son contrôle de proportionnalité ? C’est affaire de juriste. Aboutit-on à une méconnaissance des exigences opérationnelles qui désarmerait le pouvoir ? Les professionnels de l’ordre public le feront valoir sur telle ou telle mesure. Mais il est difficile de conclure que le Conseil constitutionnel est allé au-delà de ce qui est nécessaire à la coexistence des libertés en n’autorisant pas les outils nécessaires à réprimer le répréhensible.
En second lieu, les questions de sécurité sont de plus en plus liées à l’évolution des technologies, depuis les métadonnées et les messageries cryptées jusqu’aux drones en passant par les techniques algorithmiques. Au regard de la complexité des enjeux, de la découverte progressive de l’utilité et de l’impact de ces techniques, il ne paraît pas choquant qu’on tâtonne, que le processus soit itératif et qu’il y ait un dialogue entre les différents pouvoirs. Les drones en sont un exemple caractéristique : une ordonnance de juge des référés[9], une décision au fond[10] du Conseil d’État puis un avis de la Section de l’intérieur[11]qui appellent le législateur à intervenir, ce qu’il fait même s’il doit s’y reprendre à deux fois en raison d’une première censure du Conseil constitutionnel[12].
Que ce dernier ait été trop vétilleux ou non, il est certain, d’une part, que le législateur avait été prévenu et qu’il a insuffisamment tenu compte de l’avis de la Section de l’intérieur en étendant l’utilisation de la technique à toutes les infractions, en ne limitant pas sa durée ni son périmètre. D’autre part, les forces de sécurité ont de nombreux mécanismes à leur disposition : caméras individuelles, caméras installées sur des aéronefs, caméras embarquées, vidéoprotection, captation d’image réservée à la criminalité organisée, vidéo surveillance des lieux publics … Au fond c’est peut-être moins le contrôle du juge qui réduit leur efficacité que la difficulté de saisir la complexité de ces différents régimes issues de lois répétitives qui les soumettent à des règles différentes[13].
Au total, il est difficile de se convaincre que le barycentre du pouvoir s’est déplacé à tel point qu’on puisse parler d’une suprématie judiciaire. Les questions qui divisent la politique et la société française demeurent tranchées par les pouvoirs exécutif et législatif. Admettons néanmoins, pour faire l’exercice, que le dommage causé par les juridictions à la souveraineté nationale soit tel qu’il justifie une intervention. Reconnaissons un moment la réalité d’un pouvoir juridictionnel qui serait préjudiciable au bon fonctionnement des pouvoirs publics. Les voies de correction ne sont guère aisées. On peut identifier trois familles de solutions envisageables.
La première famille regroupe les solutions les plus radicales qui relèvent de la suppression ou de la sécession : abroger la QPC, dénoncer les traités … en clair claquer la porte des enceintes qui fixent des règles trop rigides ou qui imposent des limitations trop importantes aux choix politiques nationaux. Cette voie suscite toutefois deux types d’interrogations. La première est que le fléchissement des garanties juridiques conçues pour encadrer l’action de l’exécutif n’est pas une garantie de son efficacité. La seconde interrogation tient à ce que l’on sait désormais que les coûts politique, économique, et même juridique d’un opt out peuvent être disproportionnés au regard de la contrainte subie.
La deuxième famille de solutions consiste à affaiblir le contrôle du juge, en particulier celui qu’il exerce sur la loi, au regard des normes supérieures. Plusieurs formules sont évoquées. Il serait possible de réduire sa capacité de censurer ou d’écarter l’œuvre du législateur en s’inspirant de la déclaration d’incompatibilité anglaise qui n’affecte pas le texte mais permet le déclenchement d’une procédure législative accélérée pour remédier au défaut constaté. En Nouvelle-Zélande, le contrôle juridictionnel est encore inférieur :les tribunaux ne peuvent refuser d’appliquer la loi en cas de méconnaissance des droits fondamentaux. Lorsqu’un conflit de normes apparaît le juge doit s’efforcer de procéder à une interprétation conforme qui, alors, s’impose[14].Une position intermédiaire est celle du Canada où le législateur peut utiliser la clause « nonobstant »[15] qui lui permet de protéger temporairement une disposition incompatible avec les droits et libertés constitutionnels. Dans le même sens, mais cette fois ex post, on pourrait imaginer que le Parlement maintienne, à la majorité qualifiée, une disposition législative censurée par le juge constitutionnel. Toutes ces solutions relèvent du Constituant. Neutraliser le contrôle de constitutionnalité moins de quinze ans après l’entrée en vigueur de la QPC dans un pays qui a tardé à instituer pleinement le contrôle de constitutionnalité ne serait néanmoins pas un bon signe politique et juridique. En outre, il s’agirait d’une réponse décalée au regard du problème posé : nous sommes prêts à avoir un juge musclé. On voudrait seulement qu’il donne moins de coups ou qu’il les ajuste mieux.
La troisième famille de solutions rassemble les notions qui permettent de redonner une marge au local et de créer des poches sélectives de dérogations. Certaines d’entre elles existent déjà et on retrouve dans cette catégorie, dans des champs juridiques différents, les notions de marge d’appréciation, de subsidiarité, d’identité constitutionnelle, d’intérêts fondamentaux de la Nation. Ces options ont cependant un point commun : elles laissent subsister le contrôle du juge. Elles le renforcent même sans doute tant ces notions sont plastiques et se prêtent puissamment à l’exercice du pouvoir d’interprétation du juge, et même des juges, car bien souvent elles devront être appliquées à un même objet par le juge national et une cour internationale, laissant la place à une discussion redoutable entre les juridictions.
De ce cheminement je déduis donc qu’on n’est pas entrés dans l’ère judiciaire qui inquiète tant et qu’intervenir pour réduire le pouvoir des juridictions n’a, en tout état de cause, rien de simple. Jean-Eric Schoettl défend l’idée que le rôle croissant du juge dans son exercice de contrôle des pouvoirs exécutif et législatif échoue à apporter des résultats supérieurs en termes de qualité de gouvernement. Ses opposants continueront d’insister sur le rôle souhaitable et utile du juge pour prévenir les dérives des institutions élues. Après tout, la légitimité simultanée des deux positions est équivalente. Le retour au premier plan du débat démontre peut-être que le pouvoir du juge est inversement proportionnel à la netteté des frontières entre les pouvoirs. Le juge a un pouvoir plus grand lorsque les pouvoirs sont moins distinctement séparés. C’est aussi une explication du rôle croissant du juge. Il n’y a plus de version canonique, unique, de la séparation des pouvoirs. Elle est autant un principe qu’une pratique qui reflète les nécessités, les idées, l’habileté et les luttes politiques du moment. Elle est affaire de négociation et est portée devant l’opinion. Si les juges imaginent qu’ils peuvent sauver leur pays d’excès démocratiques qu’ils sont seuls à percevoir, ils mettent en péril leur propre légitimité sans pour autant influer réellement sur le résultat du débat politique. Les forces de rappel existent. Le livre de Jean-Eric, les débats auxquels il donne lieu et le colloque d’aujourd’hui en font partie.
Revenons, pour terminer, à l’intitulé de la question posée : une diabolisation du rôle des juges ? La politique contre le droit ? La vision politique du juge est une licorne, une créature imaginaire sur laquelle on écrit des fables. On les idéalise. Elles sont parfaites. On écrit des fables sur elles. On les chasse. Le seul problème c’est qu’elles n’existent pas. Elles n’ont jamais existé. Elles sont l’image rêvée du rhinocéros, l’animal à corne unique idéalisé par l’imagination médiévale. Le juge est un rhinocéros. Il est parfois lent, trapu, surprenant à regarder et difficile à aimer. Mais il est réel. Il existe. Et il est redoutable.
Wanda Mastor, Professeure à l’Université de Toulouse Capitole
Denys de Béchillon, pour un colloque à l’intitulé quelque peu provocateur, m’a demandé de traiter une question qu’il appelait pourtant à « dissoudre » dans
un écrit de 2002[16]. Sans doute inconsciemment pour l’agacer, j’ai moi-même publié un plaidoyer pour le gouvernement des juges[17] avant, non de faire un
mea culpa, mais de tirer les conséquences d’une plus grande expérience du droit américain[18].
Je commence par rappeler une donnée méthodologique évidente pour les comparatistes, famille d’anciens incompris soudainement devenus aussi
populaires que les influenceurs : le regard comparatiste, tout indispensable qu’il est, doit demeurer humble. Tout n’est pas comparable et encore moins transposable. S’il y a bien une expression dont il faut se méfier, surtout lorsqu’on veut la faire voyager, c’est celle du gouvernement des juges. D’une expression doctrinale née de l’observation d’un système parfaitement étranger au nôtre, « le gouvernement des juges » s’est mué en slogan chéri des sceptiques et autres « anti-tout ».
Réfléchir sur le gouvernement des juges, en France et aux États-Unis, se fonde sur des postulats théoriques, des cadres institutionnels, des contextes
culturels, radicalement différents. Abolition de la peine de mort, dépénalisation de l’avortement, dépénalisation de l’homosexualité, mariage entre personnes du même sexe sont autant de libertés offertes, en France, par le législateur. C’est la République qui a permis aux individus d’embrasser ces « grandes »
libertés. Aux États-Unis, c’est, non la justice, mais les neuf juges de la Cour suprême fédérale qui les ont offertes, parfois retirées comme dans le cas
de l’avortement, exception faite de la première mais dont les contours sont largement définis aelle. Notre loi du 15 janvier 1975 est « leur » décision Roe v.Wade de 1973 ; celle du 17 mai 2013 « leur » Obergefell v. Hodges de 2015. Les exemples pour la France ne peuvent néanmoins pas être étirés à l’infini, encore moins ces dernières années et ce n’est sans doute pas François Sureau qui me contredira.
Surtout, ce parallélisme, qui est ici utile pour la démonstration, ne saurait me muer en légicentriste ou passionaria de la représentation nationale : exprimer de temps à autre mes réserves face à la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, ne m’empêche de continuer, dans le même temps, à défendre avec ardeur les vertus de la justice constitutionnelle. Elle demeure une sentinelle préventive et parfois salvatrice. Bien évidemment, tant le Parlement que le juge peuvent être aussi les artisans de la privation de nos libertés ; mais l’américaniste est sceptique quand il est question de hurler au gouvernement des juges en France.
Il convient ici de démontrer, non seulement l’absence de pertinence de la comparaison, mais aussi le fait que le gouvernement des juges n’est pas plus accepté aux États-Unis qu’il ne l’est en France[19]. Comme il n’y est pas non plus une évidence, un produit de l’histoire, une fatalité. Y compris depuis que la Cour suprême est revenue sur la protection fédérale du droit à l’avortement. Le gouvernement des juges a en réalité toujours été une menace, dans les deux systèmes, dont j’observerai tout d’abord les fondements politiques, puis les critiques juridiques, avant de conclure sur le regain politico-juridique. Menace réelle aux États-Unis qui, en France, ne dépasse cependant pas le stade du fantasme.
Le fondement politique de la menace
Par « politique », j’entends le jeu démocratique. On peut parfois lire ou entendre l’idée suivante : en résumé, le gouvernement des juges serait plus acceptable aux États-Unis en vertu de la place qui y est accordée au peuple et notamment de son pouvoir d’élire certains juges. Par conséquent, puisque les juges sont élus, ils seraient logiquement légitimes à gouverner. Or il n’en est rien.
En France, c’est à nos représentants que nous abandonnons notre parcelle de souveraineté. Pouvoir premier et ultime dans une démocratie qu’à aucun moment, nous n’offrons au juge, lequel décide « au nom du peuple français ».Mais l’action concrète de ce moment à la fois terrible -le mandat n’étant pas
impératif- et merveilleux -nous sommes les souverains- où nous transférons par le vote la souveraineté de nos mains à celles de nos représentants, n’existe pas dans le processus de désignation des juges. Il est donc tout à la fois logique et cohérent que ce soient nos élus, et non les juges, qui nous gouvernent.
Aux États-Unis, où deux pouvoirs judiciaires coexistent en raison de leur forme fédérale, le raisonnement diffère selon le système observé. Au sein des trois-quarts des États fédérés où les juges sont élus, l’idée démocratique gravée entête de la Constitution, We, the People, est poussée aux extrêmes de son essence. Le peuple est souverain notamment parce qu’il désigne, mais aussi destitue ses élus, y compris ses juges qui ne respecteraient pas le contrat initial. La souveraineté n’est pas abandonnée ; elle n’est que transférée pour des exigences de gouvernement pratique mais le caractère impératif des mandats vient sans cesse rappeler la puissance des trois mots ouvrant la Constitution. L’analyse est évidemment différente au niveau de la justice fédérale. Même si la nomination des juges suit parfois une logique de miroir sociologique du peuple incarné, la justice n’est plus l’émanation directe du peuple et décide d’ailleurs en son nom propre. Pour le dire autrement, les juges expriment leurs propres opinions, votent en leur nom personnel. C’est la première raison pour laquelle la critique du gouvernement des juges, outre-Atlantique, s’adresse aux membres de la Cour suprême des États-Unis. Les autres sont d’ordre conjoncturel et ont jailli pendant des périodes dites d’ « activisme » de la Cour, notamment celle du New Deal. On ne compte pas le nombre d’opinions dissidentes qui ont dénoncé une majorité outrepassant s amission, à l’image du juge Harlan sous l’arrêt Standard Oil, dès la fin du XIXe siècle : « Les juges n’ont pas à s’enquérir de la sagesse et de la valeur politique d’un acte du Congrès. Leur devoir est de reconnaître la volonté du législateur et, quand le statut contenant l’expression de cette volonté est constitutionnel, les cours doivent la respecter »[20].
La critique juridique de la menace
En réalité, et contrairement à une idée falsifiée, le gouvernement des juges n’est pas plus dénoncé en France qu’il ne l’est aux États-Unis. On peut parfois avoir tendance à considérer que l’hypertrophie du pouvoir judiciaire est une évidence outre-Atlantique, et que, de ce fait, elle serait plus ou moins acceptée ; or il n’en est rien, des prémisses de l’État à l’actualité.
Si, en France, c’est bien l’ouvrage d’Édouard Lambert[21] qui va donner au gouvernement des juges des allures de spectres, la paternité de l’expression, tout comme sa réalité, sont américaines. Pour mieux saisir la peur, quasi irrationnelle, qui agite encore certains commentateurs français, il faut relire attentivement Lambert et commencer par se souvenir que Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis est, avant tout, l’expression d’une profonde aversion, non pour le contrôle de constitutionnalité en général mais pour le Judicial Review en particulier.
C’est dans le contexte du débat sur le contrôle de constitutionnalité des lois sous la IIIe République que son ouvrage s’inscrit. Il y critique le Judicial Review et les auteurs français séduits par lui (Beauregard, Benoist, Jèze, Hauriou, Jalabert, Saleilles et Theller) tandis que Larnaude, Duguit et Esmein sont salués pour ne pas céder à la contagion[22].
La dénonciation de la puissance judiciaire –celle-là même qui avait, en quelque sorte, fasciné Tocqueville et Laboulaye avant lui- est vigoureuse, et s’adresse surtout aux juristes français séduits par lui. C’est vers eux que le propos de Lambert est dirigé, les alertant sur les multiples dangers que ferait naître une tentative de transposition : celle-ci pourrait fournir « le robuste corset de fer qu’ils estiment indispensable pour renforcer les cadres chancelants et crevassés de notre organisation sociale et y refouler les forces indisciplinées, déchaînées par les contrecoups de la guerre, qui tendent à les déborder et les faire éclater»[23].
Lambert analyse le système américain assez finement dans le but d’effrayer son lecteur. Mais la mise en garde, à cette époque, ne fut pas que française. Elle était aussi américaine, et il serait une erreur de croire que l’accueil de l’arrêt Marbury v. Madison[24] fut majoritairement positif.
La paternité de l’expression revient à Louis Boudin qui publie en 1911 un article intitulé « Government by judiciary »[25], qui désignera plus tard un ouvrage[26].Le livre développe des arguments classiques à l’égard de ce troisième pouvoir, qui, du stade de la quasi nullité pour les Founding Fathers citant Montesquieu dans The Federalist Papers, est passé à celui de pouvoir dominant.
Un autre texte est révélateur de la tendance critique envers l’hypertrophie du pouvoir judiciaire. Il s’agit d’un discours prononcé à New York le 27 janvier 1914par Walter Clark, Chief Justice de la Cour suprême de la Caroline du Nord. Intitulé « Government by Judges », le discours commence par rappeler que c’est par un obiter dictum de l’arrêt Marbury v. Madison que la Cour suprême s’est offert « une prépondérance écrasante », « sans qu’aucune ligne de la Constitution ne l’y autorise ». La suite du discours est un vrai brûlot. Le juge Clark fait des propositions de réformes, lesquelles ne sont pas sans rappeler
celles faites en ce moment même aux Etats-Unis. Il clôture son discours par une image biblique : « À mes frères juges (…), je citerai l’exemple des dix vierges dont la Sagesse suprême a dit : “Et cinq d’entre elles étaient sages et cinq d’entre elles ne l’étaient pas.” »
Combiné à l’ouvrage de Lambert, qui pose sur ce dernier un regard étranger, ce discours relève d’une part toute l’ambiguïté de Marbury, autant « grand »arrêt que décision obscure ; et permet, d’autre part, de mettre en relief l’impossible transposition au système français. Aucun élément, dans le débat américain sur le gouvernement des juges, ne peut être « greffé » en France. Que l’on se place sur le terrain du mode de désignation des juges, des procédures, sans oublier, peut-être avant tout, le prisme par lequel toute l’histoire des États-Unis peut se raconter : le fédéralisme.
Regain politico-juridique de la menace
La dénonciation du gouvernement des juges, une fois transposée en France, a totalement dilué la critique première qui désignait une réalité américaine. Elle a été détournée, instrumentalisée par une certaine théorie qui refusait, et refuse encore la part créative du juge. De même qu’elle alimente aujourd’hui les discours populistes qui tentent par tous les moyens de discréditer la justice. Critiquer le gouvernement du juge en France est l’aveu d’une faiblesse. Celle de ceux qui, ne pouvant prouver que le discours du juge est l’expression d’une vérité, s’attaquent aux résultats qu’ils qualifient de « politiques ». Ce faisant, ils alimentent la peur qu’ils entendaient combattre : dire que les juges « gouvernent », c’est quitter le terrain des arguments juridiques pour rejoindrele ring idéologique.
Aujourd’hui, agiter le spectre permet de dénoncer une justice « illégitime » qui dépossèderait le peuple de sa souveraineté. Force est de constater que les discours populistes des extrêmes, méprisés par les intellectuels, rejoignent pourtant bien certains de ces derniers, comme Denys de Béchillon s’attache à le démontrer[27]. Populistes et néosouverainistes ont bien en commun cette dénonciation, qui constitue un terreau dangereux jeté sur une terre de crise. Etsi la chose n’était pas aussi grave, elle pourrait faire sourire : les mêmes personnes, qu’il s’agisse de la classe politique, ou, plus problématique, du milieu universitaire, ont un lien à la critique du Conseil constitutionnel à géométrie variable. Tantôt il est excommunié pour oser s’aventurer sur des terres audacieuses (et dans ce cas, on hurle volontiers au gouvernement des juges) tantôt il est présenté comme le Deus ex Machina, la malheureuse métaphore des neuf Sages reprenant alors du galon.
Si le Conseil constitutionnel avait déclaré que le rallongement de l’âge de départ à la retraite était contraire à la Constitution, certains commentateurs
–peut-être les mêmes que ceux qui le vilipendent aujourd’hui pour ne pas l’avoir fait- aurait brandi le spectre. Ils ont énoncé avec assurance et fermeté pendant que les juges délibéraient que ces derniers ne pouvaient pas faire « autrement » que censurer la loi. C’est au passage formellement menaçant, et substantiellement inquiétant.
Surtout, cette histoire nous rappelle qu’au sein de notre démocratie représentative, ce n’est pas le Conseil constitutionnel qui détient le dernier mot. « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » : cet article 3 de la Constitution nous appartient ; les parlementaires peuvent notamment prendre l’initiative d’un nouveau référendum appuyé par le peuple. Et il sera demandé au Conseil constitutionnel de juger et non d’arbitrer les impuissances politiques éventuelles.
On pourrait penser que la très commentée décision de la Cour suprême américaine sur l’avortement a ravivé le gouvernement des juges. Or il n’en estrien, quel que soit le point de vue que l’on adopte sur la décision. La décision Dobbs, State Health officer of the Mississippi department of health et al. V.Jackson Women’s health organization et al rendue le 24 juin 2022[28] est sans ambiguïté: « La Constitution ne confère pas de droit à l’avortement ; Roe et Casey sont annulés ; et le pouvoir de réglementer l’avortement est rendu au peuple et à ses représentants élus ». L’opinion majoritaire estime que la Constitution ne proclame aucunement un prétendu droit à l’avortement, lequel n’est par ailleurs pas ancré dans l’histoire et la tradition de la nation américaine. La Cour juge, en substance, que l’avortement ne peut être un droit consacré au niveau fédéral et que désormais, il appartiendra aux États fédérés d’en réglementer le principe et les conditions. La plupart des avortements sont désormais interdits dans vingt-deux États en ce mois de septembre 2023[29], ou ne sont permis que dans de strictes conditions, variables, mais qui enfreignent considérablement la liberté de la femme. En réalité, c’est près de la moitié des États qui devraient tenter d’interdire l’avortement ou de limiter la durée de la grossesse, les tribunaux étant nombreux à être en train de juger siles interdictions légales peuvent entrer en vigueur.
C’est bien l’interprétation de 1973 qui est remise en cause en 2022, avec les conséquences dramatiques que l’on peut déjà constater outre-Atlantique. Mais si, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour suprême, nombreux sont ceux qui ont perdu au jeu des prédictions, il n’en demeure pas moins que le droit à l’avortement reposait sur des fondements instables. Parce qu’il dépendait dangereusement de la branche judiciaire du pouvoir. Et qu’il appartenait aux élus de s’en saisir, pour ne pas laisser le corps de la femme dans les mains de neuf juges nommés. Le droit à la contraception, l’homosexualité ou le mariage entre personnes de même sexe risquent de connaître la même funeste destinée, à moins que le Congrès ne vienne consolider leur protection judiciaire. Tirant les leçons du cataclysme que représente l’arrêt Dobbs, le Congrès a ainsi adopté le 13 décembre 2022 une loi protégeant le mariage entre personnes du même sexe. Le Respect for Marriage Act[30] abroge des législations antérieures définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme et interdit aux agents d’état civil, sur tout le territoire, de discriminer les couples « en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine ». Ou comment faire jaillir la lumière législative d’un obscur puit judiciaire.
Pendant les échanges antérieurs à la décision entre les juges et les partis, rebondissant sur les propos du procureur Stewart, la juge libérale Sottomayor a demandé : « Cette institution survivra-t-elle à la puanteur que cela crée dans la perception du public – le fait que la Constitution et sa lecture ne sont que des actes politiques ? ». Elle n’a pas attendu de réponse pour ajouter : « Je ne vois pas comment c’est possible ».
Mais en réalité, Roe v. Wade était tout autant politique. Juridiquement mal fondée et politique. Parce qu’en droit, être libéral ne doit pas, ne devrait pas, être plus acceptable qu’être conservateur. En 2023, comme en 1973, c’est au Congrès, et non à la Cour suprême, de proclamer ou interdire un droit. Dobbs est le produit d’un pays profondément divisé, et la Cour suprême le reflet du dysfonctionnement actuel du régime américain. Mais il faut avoir confiance au peuple américain qui a souvent rappelé que de tous les pouvoirs, il était le premier : « We, the people » est la phrase d’où le pays est né et peut-être que paradoxalement, le séisme que représente l’arrêt Dobbs va être l’occasion de le rappeler. Aux États-Unis, comme en France, le système choisi fut celui du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C’est même une devise qui synthétise parfaitement les deux Républiques puisque l’article 2 alinéa 5 de notre Constitution qui le proclame s’approprie mot pour mot l’adresse de Gettysburg d’Abraham Lincoln de 1863. La question ici traitée n’est finalement pas une question de politique contre le droit ou du droit contre le politique ; elle est une question d’équilibre des pouvoirs au sein d’une démocratie.
[1] Il ne s’applique qu’aux « personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, aux comptables publics, aux dépositaires publics ou à leurssubordonnés ».
[2] Qui prévoit, de façon générale et claire, qu’« aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».
[3] D. de Béchillon, « Le Gouvernement des juges : une question à dissoudre », D. 2002.973.
[4] W. Mastor, « Énième retour sur la critique du « gouvernement des juges » », Pouvoirs n°178,2021, p. 49.
[5] CE ass., 21 avril 2021, n°393099 et autres, French Data Network et autres, Rec. avec les concl. A.Lallet.
[6] Décision n°2021-822 DC Loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au Renseignement.
[7] Décision n°2023-850 DC du 17 mai 2023.
[8] De l’esprit des lois, XI, 6.
[9] CE, ord., 18 mai 2020 n°440442 La Quadrature du net, Ligue des droits de l’homme.
[10] CE 22 décembre 2020, n°446155, Association La Quadrature du Net, Rec.
[11] Avis CE Section de l’intérieur n°401214.
[12] CC 20 mai 2021 n°2021-817 DC Loi Sécurité globale ; CC 20 janvier 2022 Responsabilité pénale et sécurité intérieure.
[13] cf. E. Vergès « La preuve par l’image : symptôme d’un mal aigu », RSC 2023 p. 150.
[14] New Zealand Bill of Rights Act 1990, section 4 et section 6.
[15] “Not withstanding”: Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 33.
[16] Denys de Béchillon, « Le gouvernement des juges : une question à dissoudre », Recueil Dalloz,
n° 12, 2002, p. 973.
[17] « Plaidoyer pour le gouvernement des juges », in Stéphane Mouton, Le régime représentatif à
l’épreuve de la justice constitutionnelle, LGDJ, 2016, pp. 63-74.
[18] Dont cette contribution est en partie reprise : « Énième retour sur la critique du
gouvernement des juges. Pour en finir avec le mythe », Pouvoirs, La justice, regards critiques,
n° 178, p. 37-50. 76
[19] Tout comme -les deux sont liés- il est faux de continuer à affirmer que la Constitution est vénérée sans nuance aux États-Unis. Voir notre article à paraître, Mathieu Carpentier et Wanda Mastor, « Vénérer la constitution », Pouvoirs, n° 187, La constitution, novembre 2023, p. 89-100.
[20] Standard Oil v. United States, 221 US 75 (1897).
[21] Édouard Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris,Giard, 1921, rééd. préf. Franck Moderne, Paris, Dalloz, 2005, 276 p.
[22] Édouard Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, op. cit.,p. 14.
[23] Ibid., p. 222.
[24] 5 US (1 Cranch) 137 (1803). Voir Élisabeth Zoller, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, Dalloz, 2010, n°1, p. 1-28 ; Élisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel, PUF, collection droit fondamental, 2021, pp. 113-133 ; Idris Fassassi, La légitimité du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois aux États-Unis. Étude critique de l’argument contre-majoritaire, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des thèses, vol. 165, 2017, spécialement le chapitre préliminaire, Les fondements de la difficulté contre-majoritaire : Marbury v. Madison, et le mythede l’usurpation, p. 54-130.
[25] Louis Boudin, « Government by Judiciary », Political Science Quarterly, vol. 26 (1911), p. 238-270.
[26] Louis Boudin, Government by Judiciary, Boston, Ginn & Company, 1911. Puis, quelques années plus tard, en deux volumes, Louis Boudin, Government by Judiciary, 2 vol., New York, W. Godwin,1932.
[27] Denys de Béchillon, « La Ve République résisterait-elle aux populismes ? », revue Commentaire, 2020/2 (Numéro 170), pp. 277-280 et Id., « Le néosouverainisme, cet aveuglement idéologique », L’Express du 10 décembre 2020, p. 68.
[28] 597 U.S. (2022). Voir mon commentaire de ladite décision à paraître, « La cour suprême et le droit à l’avortement : chronique d’une fragilité », in Idris Fassassi (sous la direction de), La Cour suprême des États-Unis en question, éditions Panthéon-Assas, 2023.
[29] Le New York Times publie en temps réel l’évolution des lois sur l’avortement dans chaque État : https://www.nytimes.com/interactive/2022/us/abortion-laws-roe-v-wade.html.
[30] H.R.8404, Public Law No: 117-228, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/8404.